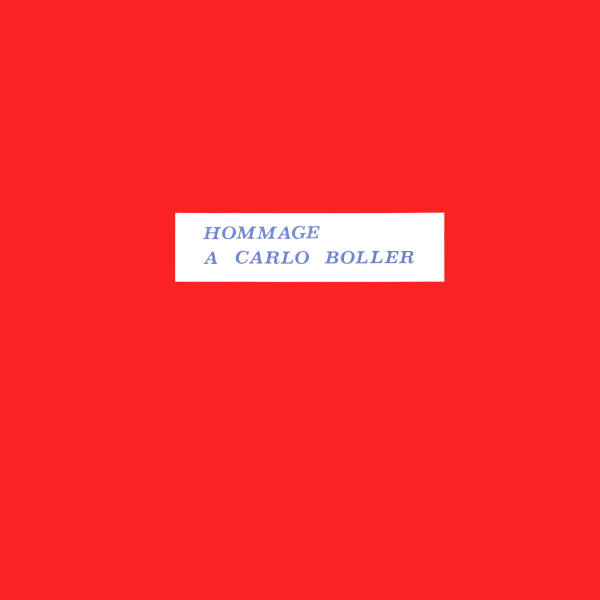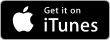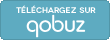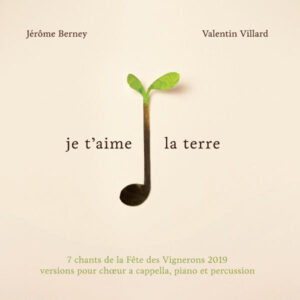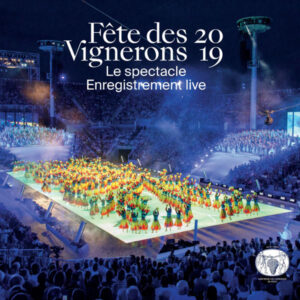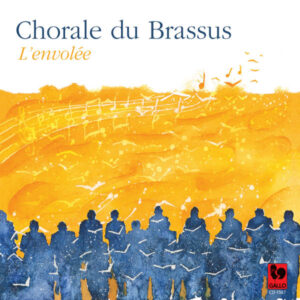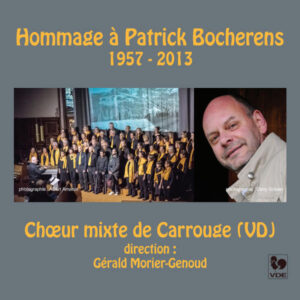Extraits / Excerpts
Hommage à Carlo Boller (Live) Enregistré en public lors du concert du 16 mai 1971 à la Salle du Pavillon de Montreux
Traditional: Ouverture – Carlo BOLLER / Maurice BUDRY: Chant du drapeau – La chanson du dimanche – Carlo BOLLER / Fernand RUFFIEUX: La Ronde du printemps – Carlo BOLLER / Maurice BUDRY: La vigne de printemps – Le Berceau du printemps – Carlo BOLLER / Robert JAQUET: Par un beau jour de mai – Traditional: A la claire fontaine (Arr. by. Carlo Boller) – Carlo BOLLER / Fernand RUFFIEUX: Nostalgie – Les armaillis du Pays bas – Carlo BOLLER / Robert JAQUET: Les faneuses – Carlo BOLLER / Maurice BUDRY: Hymne à la patrie – Traditional: Agonie (Still Away) [Arr. By. Carlo Boller] – Terre promise (Deep River) [Arr. By. Carlo Boller] – Carlo BOLLER / Traditional: Christus Vincit – Traditional: Le Petit Gars (Arr. By. Carlo Boller) – L’amour de moy (Arr. By. Carlo Boller) – De quoi nourrit-on les femmes (Arr. By. Carlo Boller) – Carlo BOLLER / Louis GRIVEL: Sylvie – Carlo BOLLER: Addio mia bella – Carlo BOLLER / Maurice BUDRY: Bon voyage, vin de ma vigne – Le vigneron monte à sa vigne
La Lyre de Montreux, Henri-Robert Ruchet, direction
Chœur des Alpes de Montreux, Olivier Nusslé direction
Petit Chœur du Collège de Montreux, Michel Hostettler, direction
La Montreusienne, Olivier Nusslé, direction
La Chanson de Montreux, Danielle Dubois, direction
L’Orphéon de Neuchâtel, Francis Perret, direction
Chœur Mixte de Bulle, Paul-André Gaillard, direction
Chœur d’Hommes Francis Perret, Francis Perret, direction
Chœur Mixte Paul-André Gaillard, Paul-André Gaillard, direction
Chœur d’Hommes Olivier Nusslé, Olivier Nusslé, direction
Chœur d’Hommes de Glion, Baptiste Bortolotta, direction
Fils de Jean-Henri Boller et de Rose-Marie née Grande d’origine italienne, Carlo Boller est né à Menton, sur la Riviera française, le 4 mai 18962. Son père exerçait la profession de tailleur-coupeur et passait la plus grande partie de sa vie professionnelle entre Menton, l’hiver, et Montreux l’été. Les Boller sont originaires de Pfäffikon dans l’Oberland du canton de Zurich où une famille de ce nom est déjà citée en 1423.
Dès son plus jeune âge il étudie le violon avec Ladislas Gorki, virtuose d’origine polonaise qui lui donne son surnom de Carlo. Plus tard il sera placé sous le patronage de l’abbé Bernard Kolly, ami des arts et compagnon de l’abbé Joseph Bovet. À seize ans, il joue comme soliste à Montreux avec l’orchestre du Kursaal et le 8 août 1920 il interprète encore une chaconne de Bach à l’occasion de l’inauguration des orgues de l’église paroissiale du Châtelard où fut créé « Dismas » de l’abbé Bovet3. On peut rappeler aussi un récital avec la pianiste Clara Haskil à Neuchâtel en 1922 de même que sa collaboration avec le quatuor de Ribaupierre composé dans la formation initiale (1917-1924) d’André et d’Emile de Ribaupierre, violons, Carlo Boller, alto et Jean Décosterd, violoncelle. Il part pour Paris afin d’y poursuivre ses études mais, victime d’une crampe du petit doigt de la main gauche (la « crampe du violoniste » connue maintenant sous le nom de « dystonie focale »), il doit renoncer à sa carrière de violoniste.
En 1927, avec l’aide de Gustave Daumas, Marc de Ranse et Paul Doncœur, il publie la première version du recueil de chant populaire Roland.
Il trouve alors sa nouvelle orientation à la Schola Cantorum de Paris, où il reçoit l’influence de Vincent d’Indy. Il persévère dans le domaine musical pour devenir chef d’orchestre (premier prix en 1928, diplôme en 1932) avec un intérêt accru pour la chanson populaire. En 1926, toujours à Paris, il fait la connaissance de son épouse, alors étudiante, Erminia Martini, née à Crémone dont il aura cinq enfants: Jean-Marie, Françoise, Marie-Noëlle, Rose-Marie et François. Le mariage est célébré à Châtel-Saint-Denis le 29 décembre 1928.
De retour en Suisse, il s’installe à Vevey, où il dirige plusieurs chœurs et groupes vaudois et fribourgeois. Il reprend de l’abbé Léon Sesti la direction du chœur de femme de Nyon, « les Chanteuses de la Colombière », qu’il dirigea jusqu’après la guerre et avec lequel il grava ses premiers disques. La même année, le « Groupe choral de Gruyères » fait appel à lui pour le diriger, ainsi que le Quatuor vocal des routiers de Châtel-Saint-Denis. De 1933 à 1939, il est à la tête du « Chœur mixte du corps enseignant de Vevey-Montreux » où ses qualités pédagogiques sont très appréciées. De 1932 à 1952, il dirige l' »Union chorale de La Tour-de-Peilz ». En 1935 il s’installe à la villa Sainte-Claire à Montreux. De 1934 à 1952, Boller dirige le « Chœur mixte de Bulle » qu’il marque de sa puissance de travail et de son rayonnement personnel. C’est avec cet ensemble auquel se joignait parfois l’Orchestre de la Ville de Bulle qu’il crée la « Pastorale gruyérienne ». Avec cette chorale bulloise, il présente aussi plusieurs œuvres classiques de Bach, de Haydn et de Gluck, notamment « Orphée et Eurydice ». En 1935, il succède à Alexandre Dénéréaz au pupitre du « Chœur d’hommes de Lausanne ». En 1936, il reprend le « Chœur des Alpes de Montreux ». En 1937, il fonde la « Chanson vaudoise » avec laquelle il se déplace souvent à l’étranger. En 1939, il fonde la remarquable « Chanson de Montreux », société qui très vite atteint à la célébrité en Suisse et à l’étranger. Cette même année 1939, Boller rassemble un grand chœur pour l’exposition nationale de Zurich. De 1942 à 1952, Boller attache son nom à la ville de Neuchâtel en dirigeant le chœur d’hommes « l’Orphéon » et au village de Corcelles (NE) où il constitue un petit chœur d’enfants pour lequel il écrit le ravissant « Petit chaperon rouge ». En terre valaisanne, il dirige le « Petit chœur des Mayens de Sion ». En 1951, Boller regroupe le « Chœur mixte de Bulle » et l' »Union chorale de la Tour-de-Peilz » pour monter le « Chant de la Cloche » de Vincent d’Indy qu’il dirige à Menton à la tête de l’orchestre Nice-Côte d’Azur. Ce concert mémorable marque le centenaire de la naissance de d’Indy. Rappelons que Boller a également préparé les chœurs pour le « Saint François d’Assise » (1949) d’Arthur Honegger et le « Barba Garibo » (1949-1950) de Darius Milhaud.
- Catégories
- Compositeurs
- Interprètes
- Booklet
- Bortolotta Baptiste
- Chœur d'Hommes de Glion
- Chœur des Alpes de Montreux
- Chœur Mixte de Bulle
- Dubois Danielle
- Gaillard Paul-André
- Hostettler Michel
- L'Orphéon de Neuchâtel
- La Chanson de Montreux
- La Lyre de Montreux
- La Montreusienne
- Nusslé Olivier
- Perret Francis
- Petit Chœur du Collège de Montreux
- Ruchet Henri-Robert