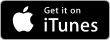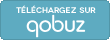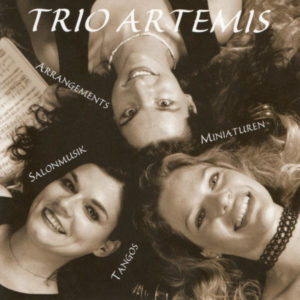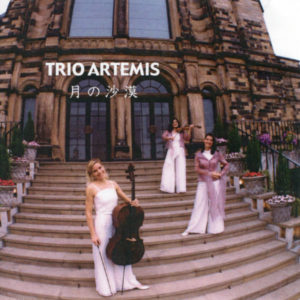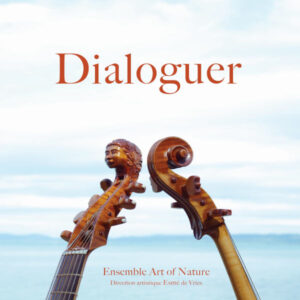Extraits / Excerpts
Fauré: Cello Sonata No. 1, Op. 109 - Sérénade, Op. 98 - Cello Sonata No. 2, Op. 117 - Romance, Op. 69 - Rolf Looser - Urs Voegelin
Gabriel FAURÉ: Cello Sonata No. 1 in D Minor, Op. 109: I. Allegro – II. Andante – III. Final – Allegro commodo – Sérénade, Op. 98 – Cello Sonata No. 2 in G Minor, Op. 117: I. Allegro – II. Andante – III. Allegro vivo – Romance, Op. 69
Rolf Looser, violoncelle – Urs Voegelin, piano
FAURÉ (1845-1924)
« Monsieur, je n’aime, je n’admire, je n’adore pas seulement votre musique, j’en ai été, j’en suis encore amoureux. Bien avant que vous me connaissiez, vous me remerciiez d’un sourire dans les concerts, le tapage de mon enthousiasme ayant forcé à un 5ème salut votre dédaigneuse indifférence au succès. L’autre soir, je me suis enivré pour la première fois avec « Le parfum impérissable » (une mélodie de Fauré) et c’est une ivresse dangereuse, car depuis, j’y suis revenu tous les jours. C’est du moins une ivresse clairvoyante. »
Proust, Marcel : lettre adressée à G. Fauré en 1897, dans : Correspondance Générale, volume 2, p. 102, Ph. Kolb, éditeur (en français).
Les deux Sonates pour violoncelle et piano op. 109 et 117, composées en 1917 et 1921 à Saint-Raphaël et à Nice, reflètent et incarnent – de manière aussi typique que variée – le style de la dernière étape de la longue carrière de l’artiste. Dans cette vie, les choses ont eu le temps de mûrir sans être précipitées par une impatience effrénée ou par trop d’ambition personnelle. D’ailleurs, à toutes les étapes de sa carrière, la musique de Fauré rayonne cette distance juste et féconde qu’un vrai artiste peut et doit avoir vis-à-vis de son travail et de lui-même. On pourrait dire la même chose de sa vie, ce qui révèle une rare correspondance entre l’œuvre et la biographie.
Au-delà de leur richesse purement musicale, unique et originale, les dernières œuvres de Fauré représentent un sujet de réflexion et d’attention particulière, bien que cette attention soit encore étonnamment rare. La dernière manière de Gabriel Fauré unit paradoxalement un dépouillement et une sobriété étrangement sévères à une grande plénitude émotive, allant parfois jusqu’à l’extase.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de la dernière manière de son œuvre personnelle, mais aussi de celle d’une ère entière de la musique occidentale enracinée dans l’univers tonal et modal. C’est cela qui accentue encore son importance et lui confère une double signification.
Fauré a probablement été chargé de jouer les dernières grandes parties sur le damier de la tonalité modale, ce qui l’a conduit, vers la fin de sa vie, à s’aventurer aux frontières de ce domaine. Il l’a fait avec le flair et la sensibilité d’une vitalité extrêmement nuancée, avec une sûreté de somnambule, autant de tact que d’audace, franchissant souvent ces frontières de manière naturelle – ou bien n’existaient-elles pas pour lui ? –, devenant ainsi un novateur par voie évolutive, là où d’autres de son époque, révolutionnaires, ont voulu les briser.
Relevons quelques traits typiques de son écriture, qui caractérisent tout particulièrement la dernière phase de sa création musicale, phase qu’il inaugure avec le cycle de mélodies « La Chanson d’Eve » op. 95 (1906) et son unique opéra « Pénélope », alors qu’il souffrait déjà de graves troubles auditifs.
Sur le plan du contrepoint, on note la prédominance d’un usage simple et presque lapidaire de l’imitation à deux voix (canon ou imitation libre en strette) : c’est comme si deux oiseaux migrateurs de la même espèce se dirigeaient vers un but commun. (Les premiers mouvements des Sonates illustrent bien cela).
Sur le plan harmonique, on est fasciné par l’audace et la nouveauté des combinaisons et des enchaînements, extrêmement délicats et inexplorés jusqu’alors. Les ambiguïtés enharmoniques du système tempéré servent une grande liberté, ouvrant des voies inattendues aux harmonies chatoyantes, sans jamais menacer la cohérence ni la communication claire d’un sens musical profond. Souvent, cette texture harmonique prend forme dans un tissu précieux de figurations au piano, étrangement scintillant et dense, comme si le temps s’était doté d’une peau délicate.
Les structures mélodiques frappent par l’ampleur de leur ambitus, couvrant parfois près de trois octaves (par exemple, le 2ème thème du premier mouvement de l’op. 109). Les grands intervalles, notamment l’octave, jouent un rôle important en tant qu’éléments mélodiques.
Fauré aime déployer ses modulations subtiles en séquences, formant de vastes spirales vers des objectifs mystérieux.
Les péroraisons des mouvements sont très caractéristiques : la mélodie et l’harmonie, revenant d’un long voyage, tournent longuement autour de la fondamentale avant de s’ancrer définitivement dans la tonalité d’origine.
Ces caractéristiques rappellent Bruckner. En effet, Fauré semble être le seul musicien latin qui, dans son propre univers, occupe une place correspondant à celle du grand maître autrichien, tous deux étant en quelque sorte les grands classiques postromantiques.
Pour accomplir ce que ces deux hommes ont accompli, il faut aussi une certaine part de naïveté supérieure. On sait que Bruckner en était doté de manière monumentale et touchante. La naïveté de Fauré est peut-être moins connue ou imaginée, mais elle s’exprime par une simplicité charmante, un peu rustique, accompagnée d’une belle sérénité et d’un humour fin.
En 1906, alors qu’il composait « Chanson d’Eve » dans sa chambre d’hôtel à Stresa, il écrivait à sa femme :
« Mon texte est difficile. Il faut faire parler Dieu le Père, et puis Ève, sa fille. Ah ! Ce n’est pas commode d’avoir affaire à des personnages aussi considérables. Et pourtant, cela me semblerait bien plus impossible de faire parler en musique M. et Mme Dubois ! – Journée en soie grise, hier. Temps très chaud, très lourd… Et moi, en gilet de flanelle, j’ai travaillé sept heures, et j’ai résolu le problème de faire chanter Dieu. Quand vous verrez en quoi consiste son éloquence, vous serez tous surpris qu’il m’ait fallu tant de temps pour trouver cela. Mais, hélas ! la simplicité nue, par le temps qui court, est ce qu’il y a de plus difficile à imaginer. »
Rolf Looser
- Catégories
- Compositeurs
- Interprètes
- Booklet