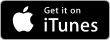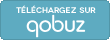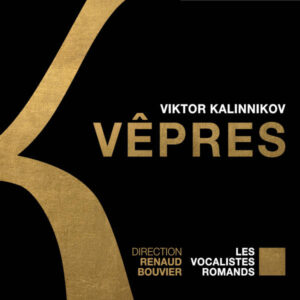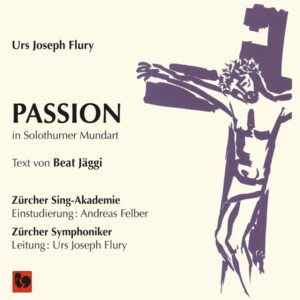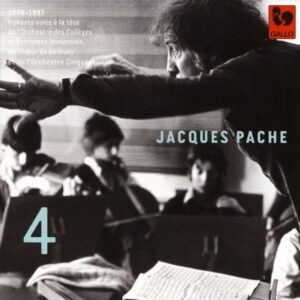Extraits / Excerpts
Fauré: Messe Basse - Franck: Panis Angelicus, Op. 12 - Langlais: Missa in simplicitate, Op. 75 - Les Petits Chanteurs de Sainte-Thérèse de Genève, Philippe Baud
Gabriel FAURÉ: Messe Basse: I. Kyrie – Messe Basse: II. Sanctus – Messe Basse: III. Benedictus – Messe Basse: IV. Agnus Dei – Salve Regina, Op. 67, No. 1 – Tantum Ergo, Op. 65, No. 2 – César FRANCK: Panis Angelicus, Op. 12 – Jean LANGLAIS: Missa in simplicitate, Op. 75: I. Kyrie – Missa in simplicitate, Op. 75: II. Gloria – Missa in simplicitate, Op. 75: III. Credo – Missa in simplicitate, Op. 75: IV. Sanctus – Missa in simplicitate, Op. 75: V. Benedictus – Missa in simplicitate, Op. 75: VI. Agnus Dei – Trois Prières, Op. 65: No. 1 Ave Maris Stella – Trois Prières, Op. 65: No. 2 Ave Verum – Trois Prières, Op. 65: No. 3 Tantum Ergo.
Les Petits Chanteurs de Sainte-Thérèse de Genève, Philippe Baud, direction.
Benoît Berberat, orgue
«On a reproché aussi à Gounod d’incliner trop à la tendresse humaine. Mais sa nature le prédisposait à sentir ainsi: l’émotion religieuse prenait en lui cette forme. Ne faut-il pas accepter la nature de l’artiste?»
Ainsi Gabriel Fauré plaidait-il sa propre cause. Dans ses compositions religieuses — tout le monde connaît l’admirable Requiem — on ne trouve point les grandiloquences sonores qui étaient alors en vogue chez les épigones français de Wagner. Tout conduit chez lui à une liturgie intime du cœur. Le recueillement, la discrétion, la fraîcheur de l’élan et la pureté du style témoignent de la même piété tendre et confiante, de la même douceur fervente qui nous ont fait rapprocher ici de la Messe Basse deux motets écrits quinze ans plus tard: Salve Regina et Tantum ergo. Pour être fort dépouillées et de moindre envergure, peut-on qualifier pour autant ces compositions de «mineures»? Nous aimerions dire tout au contraire «chefs-d’œuvre». En une époque où l’art sacré — en France comme ailleurs en Europe — avait perdu toute inspiration, où l’on errait entre les boursouflures des pompes post-romantiques et la navrante fadeur des images de Saint-Sulpice, Fauré montrait qu’il était des voies nouvelles. Organiste féru de musique ancienne — et qui pourtant à l’instar de Rameau et presque de Mozart, ces deux autres virtuoses des claviers, n’a rien composé pour l’orgue — il connaissait incomparablement les modes d’autrefois — ceux des traditions grégoriennes — et les introduisait subtilement dans son écriture harmonique, qui joue ainsi avec une virtuosité sans pareille et toujours discrète des modulations qui souvent situe sa musique aux frontières du modal et du tonal.
La Messe Basse enregistrée ici par les Petits Chanteurs de Sainte Thérèse doit sa création à une circonstance de vacances: Gabriel Fauré se trouvait en villégiature chez des amis à Villerville, sur la côte normande, pendant l’été 1879, quand il fut décidé qu’une messe «en musique» serait donnée dans l’église du village au profit de la Société des pêcheurs. Fauré et Messager, qui se trouvait également là, composèrent une petite messe pour voix de femmes, accompagnée par un harmonium et un violon solo. Malgré la pauvreté des moyens, l’œuvre rencontra un très vif succès, car elle s’accordait parfaitement par sa simplicité avec la liturgie d’une église de campagne. Mais elle demeura longtemps ignorée du grand public puisque ce n’est qu’en 1906 que Fauré se décida à publier les morceaux qu’il avait composés (voilà pourquoi manquent Gloria et Credo), non sans les avoir revus, transformés et établi l’accompagnement pour orgue seul. Par sa transparence, ses douces inflexions, cette Messe convient admirablement aux voix d’enfants, quoique n’étant pas toujours pour eux d’une exécution facile.
- Catégories
- Compositeurs
- Interprètes
- Booklet