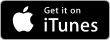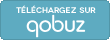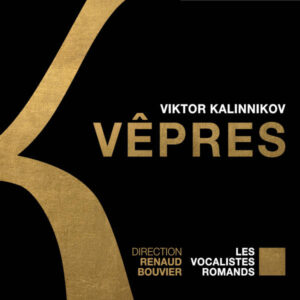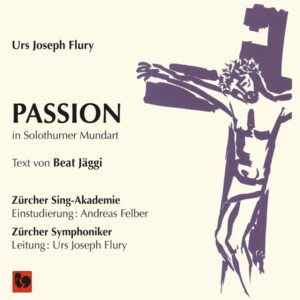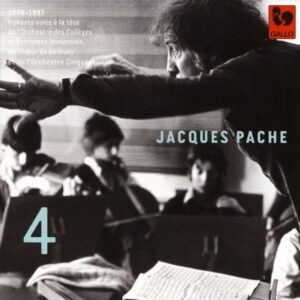Extraits / Excerpts
Haydn: Missa in Angustiis "Nelson Mass" (Live) - Orchestre de Chambre de Lausanne - Chœur de Chailly-sur-Clarens - Andras Farkas
Franz Joseph HAYDN: Missa in Angustiis « Nelson Mass », in D Minor, Hob. XXII:11: No. 1 Kyrie – No. 2 Gloria/ Gloria in excelsis Deo – No. 3 Gloria/ Qui tollis – No. 4 Gloria/ Quoniam – No. 5 Credo/ Credo in unum Deum – No. 6 Credo/ Et incarnatus est – No. 7 Credo/ Et resurrexit – No. 8 Sanctus – No. 9 Benedictus – No. 10 Agnus Dei/ Agnus Dei qui tollis – No. 11 Agnus Dei/ Dona nobis pacem
Kathrin Graf, soprano
Clara Wirz, alto
Pierre-André Blaser, ténor
Michel Brodard, basse
André Luy, orgue
Chœur J.S. Bach de Lausanne
Chœur de Chailly-sur-Clarens
Orchestre de Chambre de Lausanne, Andras Farkas, direction
https://www.ocl.ch/
La Messe Nelson est la troisième des six dernières grandes messes de Haydn. Écrite entre le 10 juillet et le 31 août 1798, elle ne s’intitule d’abord que «Missa». Plus tard, le compositeur, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la naissance, rajouta la mention «Missa in Angustiis» (Messe pour un temps d’épreuve) qui situe bien le contexte dramatique des guerres napoléoniennes dans lequel l’œuvre fut élaborée. Elle doit cependant son appellation de «Messe Nelson» au fait que le maître aurait écrit certaines parties de sa messe à la nouvelle de la victoire d’Aboukir (1-3 août 1798). Haydn semble avoir voulu exprimer, par des appels de trompettes dans la fin du Benedictus, son enthousiasme pour l’amiral Nelson, victorieux de l’armée française. Ce dernier assista du reste, deux ans plus tard, à une représentation de la messe, alors qu’il se trouvait à la cour du prince Esterházy dont Haydn était le compositeur attitré.
Cette œuvre fut composée trois ans après le second séjour de Haydn à Londres, entre les deux oratorios «La Création» et «Les Saisons». On y sent l’impulsion artistique que subit le compositeur, alors âgé de 66 ans et couvert de gloire, durant son voyage en Angleterre. On notera, en particulier, l’influence des oratorios de Haendel qui se traduit par une ampleur et une grandeur alliées à la fraîcheur toujours surprenante des idées musicales caractéristiques de Haydn.
Le Chœur J.S. Bach de Lausanne
En décembre 1928, quelques chanteurs du Chœur de Jeunesse de l’Église libre de Lausanne, désireux d’approcher une musique plus exigeante que celle qu’ils chantaient jusqu’ici, se réunirent pour donner un concert de Noël à la chapelle des Terreaux. Jean-Sébastien Bach était au programme avec, entre autres, la cantate no 91 «Béni soit ton nom Jésus-Christ». Forts de cette première expérience et conduits par Pierre Pidoux (qui deviendra l’éminent organiste et musicologue que l’on sait), ces jeunes décidèrent de préparer le «Magnificat» et c’est au mois de mai 1929 que le modeste ensemble (24 chanteurs et 12 musiciens), proche d’ailleurs de ceux qu’affectionnait le cantor de Leipzig, créa cette œuvre à Lausanne. Le public lausannois en fut enthousiasmé. Prenant dès lors le nom du grand compositeur, le chœur ainsi fondé alla de découverte en découverte : de nombreuses cantates, les Passions selon St-Matthieu et selon St-Jean, la Messe en si, sans compter des œuvres de Schutz, Buxtehude, Goudimel, Palestrina. En 1947, une nouvelle et passionnante expérience : le Roi David d’Arthur Honegger. Nommé organiste à Montreux, Pierre Pidoux quitta le Chœur Bach en 1948. Il fut remplacé par Pierre Colombo, puis par Charles Dutoit, Michel Corboz et Jean-Pierre Moeckli. Au fil des ans, l’ensemble s’était agrandi, pour atteindre l’effectif d’un grand chœur d’oratorio. Il mit périodiquement à l’affiche de ses concerts les œuvres de J.S. Bach bien sûr, mais également celles de tous les grands compositeurs. Parmi les plus originales, certaines souvent peu chantées, comme un Magnificat, un Laudate Pueri et un Gloria de Monteverdi, Josué de Handel, Elie de Mendelssohn, Le Requiem allemand de Brahms, deux Psaumes et le Pange Lingua de Kodaly. Pour célébrer son 50ème anniversaire, le Chœur donna deux concerts : à la Cathédrale, fin décembre 1978, les trois premières cantates de l’Oratorio de Noël de J.S. Bach, après avoir offert en mai au public lausannois un divertissement raffiné avec la version de concert de l’opéra d’Henry Purcell, «The Fairy Queen», d’après le Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare.
Placé depuis 1979 sous la baguette experte d’Andras Farkas, le Chœur Bach a, en particulier, donné deux créations à Lausanne : la Missa Longa de Mozart et le Te Deum du grand compositeur hongrois Zoltan Kodaly.[show_more more= »Afficher la suite » less= »Masquer la suite »]
Les Chœurs de Chailly-sur-Clarens
Le pluriel de cette dénomination s’explique par l’histoire de la fondation de cette chorale : le Chœur d’hommes du village de Chailly-sur-Clarens, fondé en 1892, décida, en 1936, sous l’impulsion de son directeur, M. Robert Piguet, professeur de chant au Collège de Montreux, de s’associer à un chœur de dames occasionnel pour exécuter des œuvres sortant du répertoire traditionnel des chœurs d’hommes. C’est ainsi que les deux chœurs donnèrent le Samson de Handel puis, en 1942, le Davel de Doret avec l’appui de l’Orchestre de la Suisse Romande. Désormais, les deux formations décidèrent de légaliser leur union et créèrent un chœur mixte, sans abandonner pour autant l’activité et le répertoire traditionnel du chœur d’hommes. Dirigé dès 1948 par Robert Mermoud, le chœur continua à cultiver parallèlement le chant populaire et la musique d’oratorio. Le chœur chanta entre autres des œuvres d’Honegger, Frank Martin, Mozart, Brahms, Robert Mermoud, etc. À marquer d’une pierre blanche la première audition en Suisse romande du Requiem de H. Sutermeister (1959). En 1968, Michel Hostettler succéda à Robert Mermoud. Sous sa direction, le chœur donna des œuvres de Haydn (La Création), Bernard Reichel, Frank Martin, etc. C’est en 1980 qu’Andras Farkas reprit la baguette et permit ainsi d’associer le Chœur Bach aux Chœurs de Chailly pour la préparation et l’exécution de la Messe Nelson qui eut lieu les 4 et 5 février 1982 à la Cathédrale de Lausanne et à la Maison des Congrès de Montreux. Les Chœurs de Chailly ont également été appelés à participer à la création du spectacle «Lo Scex que plliau», musique de Michel Hostettler sur un texte d’Henri Deblué, donné en septembre 1982 à Montreux.
Andras Farkas
Né à Budapest en 1945, Andras Farkas accomplit ses études musicales au Conservatoire Bela Bartok de cette ville. Il les poursuit à l’Académie de Musique de Vienne où il étudie le cor et la direction d’orchestre. Depuis 1972, on le voit régulièrement à la tête des meilleurs orchestres hongrois. En 1974, il s’installe à Lausanne et devient successivement directeur de la Société chorale de L’Orient, du chœur «La Persévérance» de Vallorbe, du Chœur J.-S. Bach de Lausanne et des Chœurs de Chailly/Clarens. C’est avec le Chœur Bach, la Persévérance de Vallorbe et l’Orchestre de la Suisse Romande qu’il donne en 1980 la première audition lausannoise du Te Deum de Kodaly. En 1982, il assure, à la tête du Chœur Bach, la direction du concert de Noël de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Des concerts symphoniques et des enregistrements lui sont régulièrement confiés en Hongrie, au cours desquels il dirige notamment la première exécution hongroise de la Ballade pour violoncelle et orchestre de Frank Martin et un cycle de Lieder de son père, le compositeur Ferenc Farkas. Il effectue également des enregistrements pour la Radio Suisse Romande avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne et l’Orchestre de la Suisse Romande. Il collabore depuis 1976 à la Revue Musicale Suisse et devient en 1981 membre de la Commission de musique de la Société cantonale des Chanteurs Vaudois.[/show_more]